
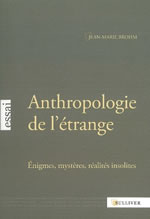
Anthropologie de l´étrange. Énigmes, mystères, réalités insolites.
L’histoire nous a légué d’innombrables énigmes, mystères et réalités insolites : l’Atlantide, les "pierres du ciel", les possessions démoniaques, la sorcellerie, la lycanthropie, le vampirisme, les enfants sauvages, les apparitions extraordinaires, les stigmates et corps à prodige, les extases mystiques, etc. L’anthropologie ne peut pas traiter ces données que l’on rencontre dans d’innombrables cultures comme de simples résurgences folkloriques, superstitions ou hallucinations. Elle doit au contraire s’interroger sur leur teneur ontologique qui n’est pas simplement du registre de l’irrationnel ou de la fiction, mais bien du registre de la constitution intersubjective des mondes vécus ordinaires.
Cet ouvrage illustre le complémentarisme des démarches de l’ethnopsychanalyse, de la psychanalyse et de la phénoménologie pour restituer la complexité de l’étrange. De nombreuses observations et découvertes attestent de l’intrication étroite entre "l’imaginaire" (les croyances, les mythes, les légendes) et le "réel" (les connaissances scientifiques, les réalités attestées, les faits historiques avérés). L’Anthropologie de l’étrange est donc l’étude critique de trois quêtes métaphysiques fondamentales : l’origine (de la vie, de l’homme), le devenir (de l’humain, de la planète, du cosmos), la pluralité (des mondes habités, des mondes vécus, des différents types d’humains ou d’humanoïdes).
Jean-Marie Brohm, docteur d’État ès lettres et sciences humaines, est professeur de sociologie à l’université de Montpellier III-Paul Valéry et membre de l’Institut d’esthétique des arts et technologies. Directeur de publication de la revue Prétentaine et de la collection du même nom aux éditions Beauchesne, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la sociologie et l’histoire du sport et de l’olympisme, ainsi que sur la philosophie du corps et l’anthropologie de la sexualité.

L’histoire nous a légué d’innombrables énigmes, mystères et réalités insolites : l’Atlantide, les "pierres du ciel", les possessions démoniaques, la sorcellerie, la lycanthropie, le vampirisme, les enfants sauvages, les apparitions extraordinaires, les stigmates et corps à prodige, les extases mystiques, etc. L’anthropologie ne peut pas traiter ces données que l’on rencontre dans d’innombrables cultures comme de simples résurgences folkloriques, superstitions ou hallucinations. Elle doit au contraire s’interroger sur leur teneur ontologique qui n’est pas simplement du registre de l’irrationnel ou de la fiction, mais bien du registre de la constitution intersubjective des mondes vécus ordinaires.
Cet ouvrage illustre le complémentarisme des démarches de l’ethnopsychanalyse, de la psychanalyse et de la phénoménologie pour restituer la complexité de l’étrange. De nombreuses observations et découvertes attestent de l’intrication étroite entre "l’imaginaire" (les croyances, les mythes, les légendes) et le "réel" (les connaissances scientifiques, les réalités attestées, les faits historiques avérés). L’Anthropologie de l’étrange est donc l’étude critique de trois quêtes métaphysiques fondamentales : l’origine (de la vie, de l’homme), le devenir (de l’humain, de la planète, du cosmos), la pluralité (des mondes habités, des mondes vécus, des différents types d’humains ou d’humanoïdes).
Jean-Marie Brohm, docteur d’État ès lettres et sciences humaines, est professeur de sociologie à l’université de Montpellier III-Paul Valéry et membre de l’Institut d’esthétique des arts et technologies. Directeur de publication de la revue Prétentaine et de la collection du même nom aux éditions Beauchesne, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la sociologie et l’histoire du sport et de l’olympisme, ainsi que sur la philosophie du corps et l’anthropologie de la sexualité.
